D’origine libanaise, Nayla Dabaji s’est établie à Montréal en 2011. Connue pour ses vidéos et ses installations, elle a reçu une formation en arts visuels au Liban et au Québec. Elle rassemble dans ses projets plusieurs pratiques comme la photographie, le dessin, l’art vidéo, l’art action et l’écriture. Ses projets ont reçu le soutien du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ses œuvres ont été présentées dans de nombreux centres ainsi qu’au Festival international des Films sur l'Art/FIFA expérimental. En 2020, Nayla Dabaji a été lauréate de la résidence Empreintes du Musée des beaux-Arts de Montréal. Une exposition de son œuvre « Documentaire en dérive » a eu lieu à Montréal au MAI (Montréal arts interculturels) du 17 mars au 16 avril 2022.
Alors que l’immigration est au cœur des questions posées à l’Occident, comment ce sujet influence-t-il une artiste originaire du Liban et établie au Québec ? Quel rôle joue la mémoire dans l’imaginaire d’une artiste qui a vécu et séjourné dans de nombreux pays avant de s’établir à Montréal ? Quelle place occupe le Québec dans son œuvre ?
Entretien avec Nayla Dabaji, artiste multidimensionnelle.
Victor Teboul : Nayla Dabaji, vous êtes née à Beyrouth, vous avez vécu au Cameroun et en France et vous vous êtes établie au Québec. Votre travail d’artiste vous a conduit dans plusieurs pays, notamment en Corée du Sud et en Irlande du Nord. Dans quelle mesure les langues et les cultures que vous avez connues influencent-elles votre travail ?
Nayla Dabaji : Après mes études en arts visuels à Beyrouth, et tout au début de ma carrière, j’ai commencé à m’intéresser aux résidences d’artistes. Je travaillais en duo avec Ziad Bitar à l’époque, et nous avons développé notre pratique artistique en voyage. Cette façon de travailler « in situ » a forgé l’identité de notre pratique et de notre réflexion, qui était très contextuelle. Nous avons été attirés et intrigués par des pays où les frontières étaient très présentes comme l’Irlande du Nord et la Corée du Sud et d’autres comme la Suisse, qui unissait dans un même pays des cultures différentes. Ces expériences ont influencé notre travail, vu que nos projets étaient le résultat d’une rencontre avec un lieu, le temps d’une résidence d’artiste. Lorsque je me suis installée à Montréal, et parce que je voyageais beaucoup moins, je me suis rendu compte à quel point mes expériences vécues dans différentes géographies/cultures avaient façonné mon identité, et étaient devenues un aspect important dans mon processus de travail.
Aujourd’hui, j’ai une approche artistique moins contextuelle, mais plus introspective, et plus axée sur la mémoire, les lieux où j’ai vécu et que j’ai visités s’y retrouvant entremêlés. En 2014, alors que je suivais des cours de fibres, je me suis intéressée à combiner mes différentes expériences et voir ce qui pouvait émerger visuellement d’une œuvre tissée, et de ce que cela pouvait dire de mon vécu. Avec le temps représenté par les fils de chaine (fils verticaux) et les coordonnées de différentes villes représentées par les fils de trame (fils horizontaux), ma recherche s’est portée sur l'intersection du temps et du lieu en tant que représentation, ou cartographie, identitaire.
«Dans mes installations, les traces de recherches sont interconnectées… je m’intéresse à leur point de rencontre, à la poésie qui résulte de ces rencontres »
Par la suite, j’ai commencé à concevoir des œuvres vidéos comme des collages, en travaillant de manière diversifiée avec des textes, des images et des sons de sources différentes – found footage, archives personnelles, sons ambiants, dessins, anecdotes ou textes littéraires. Une fois agencés, et parce qu’ils viennent de sources différentes, ces « récits » visuels, sonores ou textuels ont la particularité de laisser transparaitre plusieurs niveaux de lecture, tout en créant un certain décalage, un silence, mais aussi un espace de liberté, de réflexion, que je trouve nécessaire à toute œuvre. Dans mes installations également, les traces de recherches et fragments d’expériences, passées ou actuelles, sont interconnectées et je m’intéresse à leur point de rencontre, et à la poésie qui résulte de ces rencontres.

V.T. : L’installation Documentaire en dérive exprime l’état incertain et polymorphe de la mémoire. À une époque où l’immigration questionne et déstabilise l’Occident et sa mémoire, en tant qu’artiste originaire du Liban, quel rôle joue, d’après vous, la mémoire dans votre imaginaire ?
N. D : La place que joue la mémoire dans mon imaginaire ne prétend pas questionner la façon dont l’immigration déstabilise l’Occident. Par contre, je peux parler du Moyen-Orient (que je me plais à appeler Union de l’Asie de l’Ouest) et je peux parler de l’immigration, parce que je l’ai vécu, et je pense qu’il est primordial d’en parler aujourd’hui comme phénomène social. Pour moi, les migrations humaines sont comme des sortes de révolutions personnelles et subjectives qui échouent avant de se construire dans le temps. D’une certaine façon, elles sont ancrées dans le désir, l’instinct et l’urgence. On part souvent sans réfléchir à là où on va. On émigre avant d’immigrer. C’est ça qui rend justement les parcours migratoires tout autant mystiques, poétiques que tragiques et tout autant sujets d’idéalisations que de déceptions.
« Je porte mes mémoires comme je porte mon identité »
Quant à la place de la mémoire dans mon imaginaire, je dirai qu’elle a une fonction d’ancrage et c’est une grande source d’inspiration. Lorsque j’ai quitté le Liban, j’ai eu l’impression d’avoir rempli ma valise de souvenirs et que c’est tout ce dont j’avais besoin comme fondement pour une nouvelle vie ; sachant qu’également d’autres allaient s’y ajouter.
J’aime donc imaginer que je porte mes mémoires comme je porte mon identité, que mes archives personnelles habillent et habitent ma réalité, et qu’à travers mes œuvres, je les traduis. Mais cet ancrage est fragile et ma lecture, bien qu’engagée, est subjective. Cette fragilité me fascine tout autant d’ailleurs.
C’est pour cela que je m’intéresse à l’état changeant et non fixe de l’œuvre, que j’associe, d’une certaine façon, à l’état non fixe de la mémoire, parce que nous passons notre temps à construire et reconstruire des souvenirs. Documentaire en dérive expose le processus de travail qui a mené à la réalisation de ma vidéo Boomerang, et cela implique également de travailler sur une archive, celle du processus d’écriture et de réalisation d’une œuvre. Ce projet migre/voyage d’un endroit à un autre parce qu’il entremêle les différents lieux et paysages associés au souvenir – le Liban, les Îles de la Madeleine, le mont Mégantic, la Jordanie parmi d’autres. Documentaire en dérive raconte Boomerang et tente donc de tisser des histoires entre les lieux évoqués dans la vidéo, mais s’intéresse aussi à leur lecture et à leur reconstruction dans d’autres lieux, comme au lac Ontario, à Sandbanks.
V.T. : Votre projet « Who said that something happened ? » a été imprégné par la guerre que vous aviez vécue en 2006 au Liban. Le projet propose de simuler le recours à l’oubli, de manière individuelle ou collective, après une période de crise : « Comme si rien ne s’était passé », avez-vous écrit. Alors que de nombreux mouvements prônent aujourd’hui le redressement - et donc le rappel - des injustices du passé, dans quelle mesure, d’après vous, l’oubli peut-il être réparateur?
N. D. : Ce projet est d’abord né d’un découragement et a pris une attitude ironique face à l’amnésie collective après une période de crise, comme si rien ne s’était passé. Lorsque je vivais au Liban, j’étais souvent troublée par le manque d’informations concrètes et fiables dans ma vie quotidienne : évènements non expliqués pour des raisons politiques ou médiatiques, évènements historiques non enregistrés, refugié.e.s mal répertoriés, sondages insuffisants, archives incomplètes dans les institutions, musées, etc. : ces situations malheureusement laissent souvent place à la frustration, à la paranoïa, aux théories de complot, et au manque de confiance en la réalité.
Ces situations troublantes nous amènent toutefois aussi dans d’autres directions plus créatives : celles de s’engager à trouver des solutions; ce que font beaucoup de collectifs, d’auteur.e.s et de journalistes au Liban et je trouve cela admirable. Mais pour moi, et à ma façon, en tant qu’artiste, ce qui m’intéresse c’est lorsque cette attitude devient créatrice et l’imaginaire engagé. Le recours à l’oubli, dans ce projet, n’est pas une critique du commémoratif, bien au contraire. C’est une posture, une attitude ironique, mais également, et cela peut paraitre contradictoire, une volonté d’oublier pour faire exister. Il y avait là une recherche de sens et un besoin de partage. Les témoignages de ce projet avaient été regroupés dans des livres délibérément et anonymement déposés dans des librairies commerciales à Séoul sous différentes catégories (histoire, sociologie, théâtre, etc.) et ont pris chacun des existences différentes. Et je trouve que, vu sous cet angle-là, cela fait réfléchir tout autrement à la mémoire. Et c’est peut-être ce qui vous a intrigué, et ce qui vous a poussé à poser la question ?
Et pour en revenir au sujet de la guerre et de la tragédie, cela ne m’intéresse pas d’en parler comme un journaliste le ferait. Et non, je ne pense pas que l’oubli soit réparateur. Il est nécessaire pendant un moment seulement, mais il est certain qu’il faut se rappeler des injustices du passé. Pendant le conflit israélo-libanais de 2006, que l’on a appelé la guerre de juillet, j’ai créé un blogue et j’ai proposé à des amis puis à des connaissances et des inconnus, de publier de manière quotidienne des dessins, poèmes, photographies en relation avec la guerre et ce qu’ils ressentaient. Pour sentir qu’on était ensemble, qu’on allait y arriver, et pour rester en contact. Je voulais non seulement créer un lieu de partage, mais également un lieu de sécurité, de liberté d’expression et de résistance. Le blogue Lebanon_these_days est resté en ligne une dizaine d’années. Il sera surement en ligne de nouveau, ultérieurement et pour une autre période de temps.
V.T. : Votre œuvre artistique est multidimensionnelle. Elle est axée sur la vidéo, les images, les sons et l’écrit. On entend tantôt des cris d’oiseau, tantôt le mouvement des vagues de la mer. Les mots, qui défilent à l’écran et accompagnent les images, sont écrits en français et/ou en anglais; ils expriment des moments fragmentés – de rêves ou de souvenirs. Vous vous intéressez à l’immigration et à la traversée des frontières et des pays. Les sociétés occidentales vous paraissent-elles dé-membrées, disloquées ?
N.D. : Dans mon œuvre, je ne parle pas des sociétés occidentales spécifiquement, mais bien de mon expérience personnelle. Dans mon exposition Documentaire en dérive à la galerie du MAI (Montréal arts interculturels), il y a, par exemple, une séquence photographique qui regroupe des paysages maritimes. Celle-ci est reconstituée à partir de paysages provenant de différents lieux au Liban et au Québec pour mettre en scène le souvenir d’une marche au bord de la mer. Nous sommes donc dans un paysage/chemin plutôt mental, qui en réunit plusieurs. De la même façon, dans la pièce sonore, on entend des vagues, mais nous entendons aussi des corneilles alors qu’on pourrait s’attendre à entendre des mouettes au bord de l’eau. On entend également de la pluie et du feu, simultanément, ce qui peut être perçu comme décalé, pas à sa place. Ce que vous ressentez de dé-membré et de disloqué, c’est peut-être le décalage que j’essaie de mettre en scène et qui est présent dans toute l’œuvre. Documentaire en dérive puise son inspiration dans l’idée du décalage, celui qui est engendré par les délais de la transmission électronique, ainsi que celui qui résulte de l’actualisation du passé par la mémoire.
Ma vidéo Boomerang (2019) tire d’ailleurs son nom de la vidéo/performance éponyme de Nancy Holt et de Richard Serra (1974) qui a été diffusée en direct sur une chaîne télévisée publique. Holt récite un texte poétique et entend les échos de sa propre voix dans ses écouteurs. Sa voix lui revient comme un boomerang, avec un très léger délai, se retrouvant ainsi dans un moment présent difficile à appréhender. Je trouve que cet état dans lequel Holt se retrouve est similaire à ce que je pourrai ressentir lorsque j’essaie de donner sens à des souvenirs qui me reviennent, et lorsque j’essaie de les partager. C’est donc ma vision qui est décalée, c’est moi qui vis dans un lieu mental fragmenté, entre deux rives, et qui essaie de mettre en scène cela. D’ailleurs, quand on migre, émigre, immigre... On laisse derrière une partie de soi ? Est-ce qu’elle ne nous revient pas parfois comme un boomerang ?
V.T. : Dans votre projet si touchant « Wearing a place » (2014), vous vous attachez à représenter le lieu de façon personnelle. C’est une œuvre qui revisite un lieu qui est cher à votre pratique : votre ancien atelier à Beyrouth, lieu de vos premières toiles. Ce projet explore la possibilité de traduire ce lieu en un vêtement. « C’est en me questionnant sur la possibilité de traduire la chaleur, la sensation de confort, de bien-être, de familiarité et d’harmonie avec l’espace, que je tente de transposer le lieu au vêtement. (…) Le manteau de laine protège et isole, il tient chaud », commentez-vous en évoquant votre projet. N’est-ce pas un peu vrai de la culture ? Elle nous sécurise, mais ne nous isole-t-elle pas aussi ?
« Au Liban, on utilise des couvertures en laine autant en hiver qu’en été dans les montagnes, parce que la laine est également respirante »

N.D. : Je vous remercie pour cette belle image, elle est très inspirante. C’est vrai que la culture, comme nos mémoires, nous donne un ancrage, mais peut également nous isoler. Il faut trouver le bon équilibre, je dirai. Il est tout aussi important de conserver ses mémoires que de s’ouvrir à d’autres cultures. Dans mon cas, qui me considère plutôt déracinée, je n’ai pas senti que ma culture m’a isolé des autres cultures. J’ai, au contraire, un besoin de reconnecter avec le Liban parce que j’ai parfois l’impression d’être détachée. Et pour revenir au feutre, ce qui est assez extraordinaire dans la laine, c’est qu’elle peut tenir au frais également. Au Liban par exemple, on utilise des couvertures en laine autant en hiver qu’en été dans les montagnes, parce que la laine est également respirante. Régulatrice, harmonisante ? Est-ce qu’on pourrait appliquer ces qualités à la culture aussi ?
V.T. : Vous avez écrit un article (1) sur votre séjour à Séoul en 2006 qui est un bijou d’écriture, à la fois sérieux, cocasse et même satirique, mais tellement révélateur de la vie moderne en Corée du Sud. Est-il possible, d’après vous, de poser le même regard extérieur et empreint d’ironie pour décrire le Québec, même si notre société n’est pas dans un état de guerre latent avec ses voisins ?
N. D. : Je ne dirai pas que mon regard était satirique, j’étais vraiment fascinée par ce pays et intriguée par son histoire. La Corée du Sud a été un coup de cœur pour moi en 2006. J’y suis d’ailleurs retournée en 2010 et en 2011. À mon retour de voyage en 2006, Baron et Baron, un groupe qui publiait en ligne des récits de voyage, m’a proposé décrire un récit sur mon séjour en Corée. Si on me propose d’écrire sur le Québec, je le ferai aussi. À Séoul, j’ai remis en question tout ce que je croyais connaitre, mais étrangement, et dans le fond, tout devenait vite familier, malgré la barrière de la langue. Le Québec, ça a été une différente expérience. J’ai mis du temps à m’adapter et à communiquer, alors que je maitrise le français et l’anglais. Je dirai que le Québec a été un nouveau point de départ pour moi, un lieu de transformation, avant de devenir une inspiration.
V.T. : Quelle place occupe le Québec dans votre imaginaire et dans votre œuvre ?
N.D. : Le Québec a une grande place dans mon œuvre et dans mon imaginaire, parce que c’est ici que j’ai commencé à m’intéresser à l’art vidéo, à l’expérience subjective et multiple de l’espace traversé et à la déambulation, physique ou mentale, comme pratique esthétique et artistique. Il est à la fois le lieu qui porte les autres, et un lieu qui a pris une place récente dans ma mémoire. J’ai l’impression que c’est à travers cette géographie que les autres prennent sens, ensemble dans mon imaginaire, et donc dans mon œuvre.
« C’est aux Îles de la Madeleine que toute l’inspiration de Boomerang est née… C’est ce bord de mer qui m‘a ramenée au Liban, à un bord de mer que j’ai quitté pour m’installer ici »
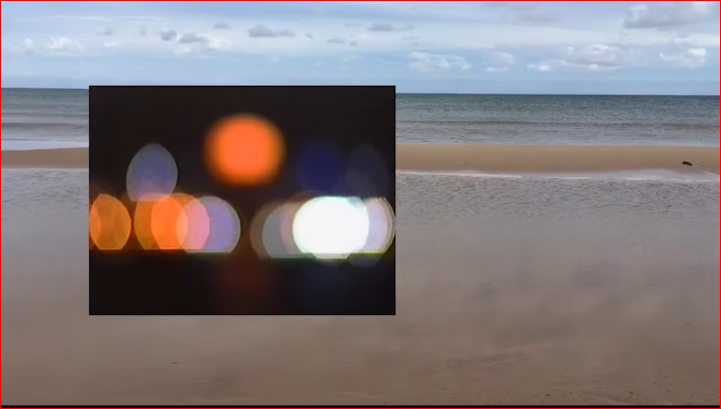
«Boomerang», voir la vidéo plus haut dans cet article.
C’est d’ailleurs aux Îles de la Madeleine que toute l’inspiration de Boomerang est née. Alors que je me promenais au bord de la mer, je me suis souvenue d’une conversation avec un ami au Liban. On avait parlé ensemble d’une scène qui était passée à la télévision, on avait parlé du jour et de la nuit, des feux d’artifices, de la lune, des manifestations. C'est ce bord de mer qui m'a ramenée au Liban, à un bord de mer que j'ai quitté pour m'installer ici. La mer, et les vagues sont pour moi une métaphore de la mémoire, dans son état en constant mouvement. J’ai par la suite visité les dunes de Sandbanks au lac Ontario, et elles ont changé toute la perspective - idées et formes - de ce que peut représenter pour moi le paysage, dans ce cas le bord d’un lac, mais qui aurait bien pu être une mer. Et c’est comme cela que j’ai décidé de la forme de Documentaire en dérive et de ma volonté de travailler à la fois sur ma mémoire et sur le processus de travail, avec comme toile de fond des paysages maritimes.
Notes
1.RÉCIT DE NAYLA DABAJI POUR BARON & BARON, « Pays du matin calme (1) : Autoroute N°3, Direction Nord » (novembre 2006, Corée du Sud).
http://www.nayladabaji.com/pays_du_matin_calme.html
Les vidéos de Nayla Dabaji sont distribuées par Vidéographe à Montréal.
Site Internet de l’artiste : http://www.nayladabaji.com/
Vous avez aimé cet article ? Tolerance.ca ne reçoit aucune forme de subvention gouvernementale ou de financement provenant d’entreprises privées ou d’organismes communautaires. Vous pouvez soutenir l’indépendance de Tolerance.ca et son esprit critique en vous y abonnant. Pour plus d’informations, cliquez ici.
Entrevue réalisée par Victor Teboul pour Tolerance.ca® Inc.
©Tous droits réservés. Aucune reproduction de cet article n’est permise sans l’autorisation écrite de Tolerance.ca® Inc.
13 avril 2022